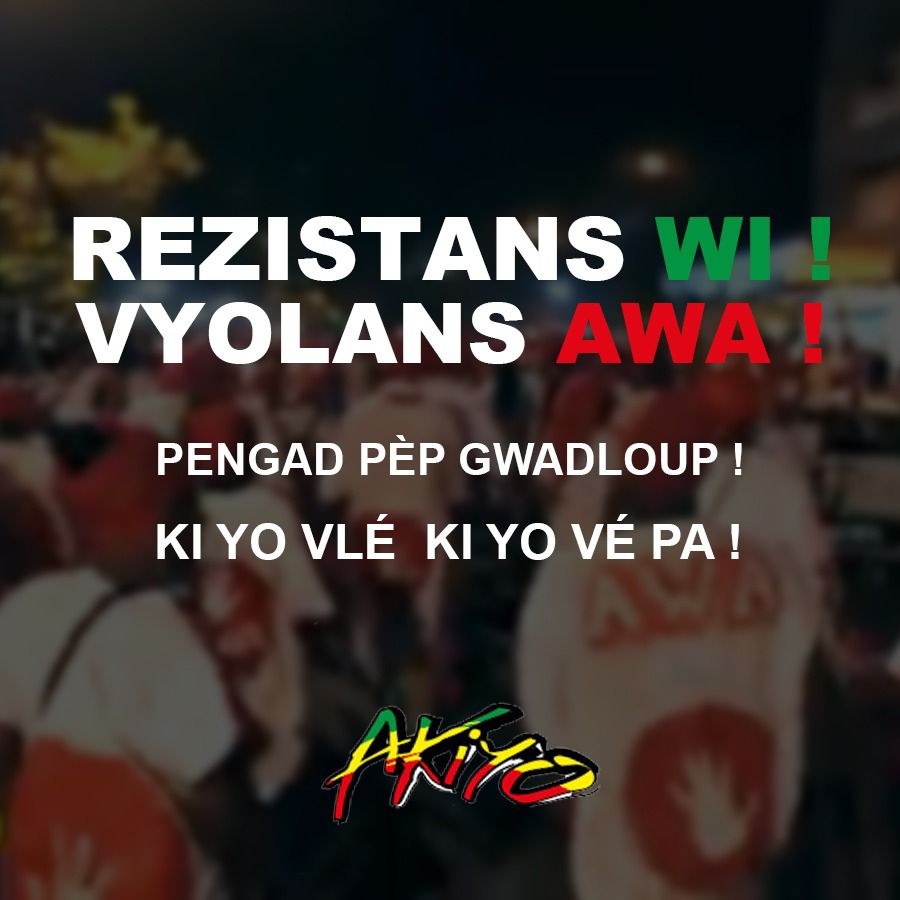Braquages, homicides, suicides, accidents mortels. La Guadeloupe est confrontée à une violence sans précédent : violence retournée contre soi, violence en direction d’autrui. Ce phénomène n’est ni nouveau, ni ordinaire. Pourquoi nous interpelle t-il aujourd’hui au point de faire naître de l’inquiétude au sein de la population ?
En rechercher les causes, elles sont multiples, les analyser, consiste à mieux comprendre afin de proposer des solutions adaptées à la réalité. Insérés dans une spirale de passage à l’acte, jeunes et moins jeunes sont emportés par ce tourbillon difficile à endiguer. Ce qui d’emblée s’impose, est l’évidence d’une paupérisation grandissante qui favorise la montée de la délinquance. La violence appartient à un vocabulaire moral et se situe dans un système de valeurs. Un proverbe chinois semble bien la définir : « On dit d’un fleuve qu’il est violent quand son cours emporte tout sur son passage, mais on ne parle jamais de la violence des berges qui l’enserrent ». La première des violences est celle de la société.
Le choix d’une fraction de la population située dans une fourchette des 15/25 ans, est susceptible de nous renseigner sur l’évolution du phénomène et surtout de se poser la question d’une Guadeloupe qui serait une machine à fabriquer des délinquants.
Le taux des jeunes de 16/26 ans rencontrant des difficultés en lecture atteint 30% contre 11,8% en France. Cet indicateur est lié au risque de décrochage scolaire. En 2024, l’académie de Guadeloupe recensait 1.869 décrocheurs, une courbe ascendante par rapport à celle de 2023 (1737). On assiste à la mise en place d’un facteur de vulnérabilité, qui plus tard va générer un sentiment d’exclusion.
Les causes de la violence s’originent dans :
- Les variables socioéconomiques
Les difficultés d’emplois stables et valorisants avec comme corollaire une précarité et des inégalités sociales sont des stigmates infâmants. Les formations dont bénéficie ce public sont souvent un pis-aller de courte durée, une occupation provisoire qui ne débouche sur rien. Rares sont les formations diplômantes pavant la voie à une profession gratifiante. De toute manière l’existence de recrutement est proportionnelle à l’absence de perspective régionale. S’ancre la pensée d’être laissé pour compte. Le manque d’activités rémunératrices favorise les trafics, toute sorte de trafic.
- Les variables familiales et éducatives.
La socialisation fait défaut dans ces familles démunies économiquement. Quels modèles ont-elles à offrir ? Quelles valeurs sont transmises ? Aucun parent ne travaille. La paupérisation doublée d’alcoolisme donne lieu à l’expression de la violence. La famille à dynamique violente s’inscrit dans la compulsion à la répétition. Le modèle nourrit des carences affectives et éducatives. Le cadre légal n’est pas énoncé : il n’y a pas de limites à l’interdit. On sort des chemins balisés par les lois sociales : « j’y ai droit. » La norme est effacée. Diverses études désignent la monoparentalité comme responsable de ce défaut de socialisation, elle accentuerait les déviances. Cependant la mère seule avec enfants a toujours su donner un cadre éducatif à sa progéniture en absence de père, père qui dans les cultures européennes énonce et représente la loi : l’interdit et le permis. Comment à une époque pas si lointaine, la mère seule imposait un frein aux débordements : c’est que le père était contenu dans la parole de la mère. La parole de la mère faisait Loi. Puis le lien familial était source de soutien indéfectible. L’entraide et la solidarité autorisaient la famille élargie à consolider le maillage affectif et sécurisant. L’histoire de cette adolescente en crise, partie un jour et une nuit, affolant son entourage, qui avait marché des kilomètres et avait dormi sous la véranda de sa grand-mère, illustre le propos. Au petit matin, les choses furent apaisées, ce qui ne l’empêcha nullement de recommencer. Mais la fugue avait pris une autre dimension.
Actuellement, la mère seule, est confrontée aux menaces agressives et parfois aux passages à l’acte. Parent humilié, battu, dissimulant des attitudes qui ont pris racine dans les comportements contradictoires : tout laisser passer puis opposer un refus inexpliqué, ne suscitent ni appel à l’aide extérieure, ni plaintes à la police. Quelques-unes s’enferment à clé dans leur chambre en proie à la terreur. Les liens familiaux s’amenuisant, elles vivent leur détresse en solitaire. L’autorité parentale semble être une pratique d’une époque révolue. Un autre paramètre s’ajoute au désarroi : les tentatives de suicide de l’enfant. Incompréhension, culpabilité, crainte de la mise en accusation, le malaise persiste d’autant plus que les tentatives d’autolyse ne débouchent pas toutes sur un décès. Le suicide est une violence retournée contre soi.
La famille à dynamique violente laisse dans la psyché une empreinte qui secrète des comportements prohibés. D’aucuns parle de gène, en désignant toute une lignée aux postures identiques. Mais il s’agit simplement d’une impossibilité à contenir ses émotions ou de trouver des voies de dégagement afin de les canaliser. Une prise en charge psychologique est salutaire.
- Les images venues d’ailleurs
Pour les plus fragiles, les jeux vidéo banalisent la criminalité. La différence entre le réel et le virtuel ne se fait pas. Tuer devient un jeu. Les startups et la facilité à l’enrichissement font rêver. Les réseaux sociaux hissent chacun à un niveau de star. La culture de rue attise l’envie. L’étalage de la réussite des autres ailleurs met en relief l’impossible d’une existence intéressante, brillante, gratifiante. Les germes de l’amertume et de la frustration commencent à éclore. Cesser de rêver dans le rêve des autres devient perturbant. Rien à faire, rien à montrer, rien à donner d’autre que sa vie. Elle se joue parfois à tout ou rien. Tuer ou être tué . Un avenir sur la base de la roulette russe qui s’aperçoit dans la désespérance et la désillusion tapies dans l’inconscient. Le qui suis-je, où gît la question de l’identité, insérée dans une triple appartenance, guadeloupéen, français, européen, fait vaciller les bases de la construction de soi. Ces jeunes n’ont pas encore la capacité à s’engager dans une appartenance distincte dont ils ne connaissent pas l’histoire. Ils sont pris au piège des besoins insatisfaits de l’île/prison où il est difficile de s’en aller. Partir où, pour quoi faire, avec quels moyens ?
La reconnaissance viendra dans l’inclusion de bandes, pas de gangs. Le gang est fortement hiérarchisé, le chef établi désigne un successeur s’il s’en faut. La bande elle, donne la possibilité de gravir les échelons à travers les trophées ramenés et leur importance. Elle est là, la reconnaissance. Braquage en plein jour, vente de stupéfiants qui implique aussi une consommation, puis les armes pour faire peur et se rassurer. Être reconnu, avoir de la valeur aux yeux de quelques-uns. Les rares, partis faire le djihad, par besoin de reconnaissance autant pour la défense d’une cause, ont donné un but à la vacuité du quotidien. L’établissement d’une loi, la leur : je veux, je prends, est une construction d’un monde différent dans l’ivresse de la domination. La rivalité entre bandes les projette dans une dimension imaginaire d’identification à la pègre américaine et au grand banditisme. Mais manger à sa faim, s’habiller, se chausser à prix d’or, sont jugés comme des élément de réussite. Nous sommes là dans l’utilité délinquante. La délinquance est un moyen de réduire la tension autant qu’une stratégie défensive face à un comportement frustré. A défaut d’exister dans le regard d’autrui- dans les quartiers les gens ne les voient pas- ils sont présents dans leurs paroles. Les médias relatent les faits. Se dessine un type de rapport social et de construction de l’échec. L échec social est vécu comme un acte héroïque et volontaire. A ceux qui affirment que l’on a toujours le choix, il faut leur répondre que pour échapper à l’échec programmé dans certains milieux, il est indispensable d’avoir autour de soi des mains tendues et bienveillantes. Se sortir seul d’une chaîne signifiante demeure compliqué.
Comprendre pour accompagner, c’est souligner que le stigmatisé échappe à la construction de soi quand il revendique le stigmate négatif. Il devient un ennemi qui ne relève plus de la morale commune. Il suscite rejet et détestation, emmuré dans son image d’inhumanité. Mais en jouit-il vraiment ? Il s’embourbe dans la haine d’autrui, refusant l’effort de banalisation de sa personne et du même coup de son effacement. La victime d’un viol porte de manière indélébile, toute sa vie, dans sa psyché, son agresseur.
Réduire les risques de violence ne saurait s’entreprendre sans ouvrir un vaste chantier en commençant par la base : l’école.
Il existe un décalage complet entre la curiosité, l’envie d’apprendre et les méthodes pédagogiques qui n’ont pas changé. Le problème nouveau et que l’école reste figée dans les mêmes façons de concevoir l’enseignement alors que la génération actuelle a considérablement évolué dans sa manière d’apprendre. L’école doit rester le lieu d’acquisition d’une certaine gymnastique intellectuelle, de savoirs de base et de connaissance culturelle. Mais ce n’est pas pour autant que ces avoirs de base et de connaissance culturelle ne peuvent pas être enseignées differemment et être plus adaptés à l’exercice de la vie adulte aujourd’hui. Les ados ne sont pas dupes, ils ont besoin de connaître l’histoire dont ils sont issus, y compris l’histoire culturelle. Ne pas jeter pour autant les auteurs classiques et les savoirs fondamentaux, mais introduire plus largement un travail sur la mémoire, la langue, les différences, le contexte historique, aideraient à forger les identités à défaut d’instruire.
La détection des dysfonctionnements de l’enfant, agressivité, instabilité motrice, doit commencer dans ce lieu d’apprentissage du vivre ensemble. Faudrait-il encore que l’enseignant soit formé à les reconnaître. Le lien établi avec l’école et la famille, les échanges féconds, permettrait une prise en charge des troubles précoces et une possible prévention. Le dialogue constructif le temps du collège venu, aurait pour but d’orienter le sujet vers des choix adaptés à ses possibilités, et de changer le rapport social de construction de réussite. Puis faire preuve d’initiative, de réflexion sous forme de programme en adéquation avec les besoins des enfants, le proposer aux instances directrices, seraient donner plus de chance à ceux qui sont sur le registre de la fatalité. Hector Poulet, Sylviane Telchid, Gérard Lauriette l’ont osé. Rassembler ses forces vives, ne pas attendre toujours sur l’autre, échapper à la victimologie. Demain peut-être.
- L’édification d’un centre de socialisation pour la primo délinquance (la place d’un jeune de 15 ans n’est pas en prison) ayant pour base la conscience de soi dans un double mouvement d’appropriation d’une humanité, l’aiderait à devenir un adulte apaisé.
- Appesantir la formation dans ces geôles non fonctionnelles, car plus on a de connaissances et d’implication sociale, plus l’insertion est réussie.
- Reste un nœud gordien : la création d’emplois en Guadeloupe relève-t-elle de la fiction ou d’un défaut de gestion du bassin de l’emploi ? Le vieillissement de la population devrait susciter une diversification dans les services à la personne (accompagnement pour les courses, les sorties, fermeture des volets, petits travaux d’urgence etc…) autant pour les femmes que pour les hommes. Ajouté à cela l’accompagnement des familles en difficultés par des professionnels en économie, en gestion du quotidien, en management de la solitude.
Sur le plan culturel :
- Donner vie aux maisons de quartiers en leur façonnant une âme.
- Construire des espaces sportifs (foot, tennis, natation) accessibles à toutes les bourses.
- Développer des loisirs collectifs (projection de film en plein air, concours de chant, de danse).
Tant de projets peu coûteux où toutes les classes sociales seraient en présence. Il suffirait simplement de sortir des tiroirs des projets datant de vingt ans dans une volonté de réalisation même tardive.
Il a-t-il plus de violence qu’autrefois ? Peut-être pas sans instrument de mesure pour l’affirmer. Mais elle est plus dangereuse avec l’usage des armes et la perte de contrôle due aux stupéfiants qui sont des activateurs. Ce qui a changé est la notion de tolérance. A la violence tolérance zéro avait énoncé un Président de la République en 2007 face à l’escalade de faits graves en France.
Peut-on la réduire ? Une transformation sociale en profondeur donnerait une possibilité aux plus démunis, d’accéder à une dignité occupationnelle et à les replacer dans leur humanité, signerait sa diminution. Une égalité des chances qui reste à inventer.
Fait à Saint-Claude le 25 septembre 2025